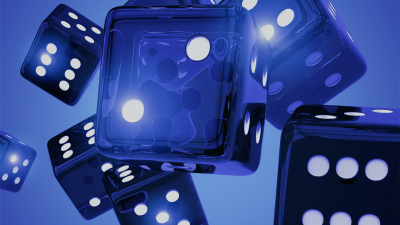SGP : Michel Mathieu, après vingt ans dans la sécurité privée, dont quatorze ans à la présidence de Securitas France, vous avez ouvert en 2019 Cogito, un cabinet de conseil en stratégie.
En parallèle, vous menez de nombreux travaux de recherche dans le domaine du management d’entreprise. C’est ainsi que vous avez soutenu avec succès une thèse de doctorat en administration des affaires en 2021 sur le sujet « management de la complexité » ; vous avez publié un essai issu de ces recherches en 2022.
Sur la base de vos travaux, diriez-vous que la mise en place d’une solution de sécurité est simple, compliquée ou complexe ?
Michel Mathieu : Nous parlons évidemment de solutions de sécurité dans le cadre de la sécurité privée, le sujet n’est pas la sécurité publique, même si les réflexions en sont proches. Il y a de multiples façons d’aborder cette question. Commençons par l’angle des ressources humaines. Mettre un agent de sécurité privée sur un site ou un événement est quelque chose de relativement simple. Il faut cependant un agent avec une carte professionnelle valide, des consignes claires de la part du client, l’assurance que les consignes sont comprises et que ses heures et ses conditions de travail respectent lois, règles et convention collective. Il faut déjà quelques compétences pour cela.
SGP : Vous dites un agent : sous-entendez-vous que, si nous parlions de dix agents, ce serait différent ?
Michel Mathieu : Absolument. Prenons par exemple un site, industriel ou tertiaire, qui nécessite la présence permanente de trois agents ; cela signifie qu’il en faut une petite vingtaine pour assurer la continuité de la sécurité au fil des jours, des nuits, des vacances et autres aléas. Cela demande déjà d’autres compétences : une organisation, un savoir-faire ou la formation permanente de cet effectif. Mais cela ne s’arrête pas là. Une société de sécurité privée comme SGP, par exemple, assure la surveillance de centaines de sites. Sa mission s’intègre dans des solutions de sécurité très différentes. De la simple télésurveillance de bureaux à risque faible au site Seveso à seuil haut en passant par des zones industrielles avec de la sécurité mobile ou des événements ponctuels, ce sont autant de problématiques différentes en matière de sécurité, de profils d’agents, de compétences individuelles ou collectives ou d’expérience, mais également en matière de capacité d’encadrement, d’animation ou de normes à respecter. En ce qui concerne les dix premières entreprises du métier, on ne parle plus de dix agents, mais de milliers.
SGP : Est-ce à ce niveau-là que cela devient compliqué, ou complexe ?
Michel Mathieu : Pour répondre, il faut d’abord poser la différence entre « compliqué » et « complexe ». Un problème compliqué se résout par la logique, la science, la norme, le savoir-faire, la compétence. Si vous avez tout cela, pour vous, le problème sera compliqué. Une situation complexe dépasse la capacité d’entendement, de compréhension de ceux qui y sont confrontés. Le complexe ne se résout pas, il se gère plus ou moins bien. Il y a des techniques pour cela, mais ce n’est pas l’objet de notre réflexion ici. En tant qu’observateur averti du monde de la sécurité privée, je vois qu’il y a peu d’entreprises sur le marché aujourd’hui qui ont tout le bagage nécessaire pour que la gestion de plusieurs milliers d’agents soit « simplement » compliquée. Pour la plupart, cette gestion est complexe ; c’est pour cela qu’il y a toujours une certaine insatisfaction du marché concernant la qualité des prestations de sécurité privée. Notons cependant qu’une large partie de cette complexité est imposée par des éléments exogènes aux entreprises elles-mêmes (augmentation des risques, droit du travail, crise du recrutement et de la compétence, incertitudes générales…).
SGP : Si je comprends bien, un même problème peut être compliqué pour certains, complexe pour d’autres. Mais vous souhaitiez aborder la question par un autre angle, lequel ?
Michel Mathieu : Dans notre réflexion, il est nécessaire d’ajouter une dimension, l’angle de la compétence, qui me semble majeure. Au-delà de la gestion de milliers d’agents dont nous venons de parler, de quelles compétences a-t-on besoin pour qu’une solution de sécurité soit efficace ? Avec le développement des risques, tant dans leur nature que de leur niveau, la liste des compétences nécessaires pour mettre en œuvre une solution de sécurité efficiente est longue et ressemble à un inventaire à la Prévert. Il faut d’abord savoir mener une analyse des risques, point de départ pour imaginer ou adapter une solution de sécurité. La solution va faire appel ensuite à de nombreuses composantes : les défenses passives (porte, serrure, clôture, fossé, éclairage…) ; les moyens humains ; les technologies matures (vidéo, contrôle d’accès, détection, alarme…) ; les techniques de gestion à distance (télésurveillance, supervision depuis un centre opérationnel de sécurité…) ; les nouvelles technologies (drone, robot, caméra intelligente, système d’hypervision1, l’I.A…). Et comme si cela ne suffisait pas, il n’est plus possible d’ignorer les besoins en cybersécurité concernant toutes ces composantes. Quand il s’agit de mettre en place tout cela, il n’y a pas de doute, c’est complexe, car personne ne peut dire qu’il a toutes les compétences nécessaires.
SGP : Certes, mais toutes les compétences existent pourtant aujourd’hui dans tous ces domaines.
Michel Mathieu : Absolument, mais ces compétences constituent chacune des silos indépendants. Dans chacun de ces silos, il y a des personnes ou des organisations pour qui la question posée sera toujours de l’ordre du compliqué. C’est trouver le bon équilibre entre tous ces silos et ne pas en oublier qui devient réellement complexe.
SGP : Faut-il prendre en compte d’autres angles qui simplifieraient ou augmenteraient cette complexité ?
Michel Mathieu : Malheureusement, je n’en vois aucun qui pourrait nous simplifier la vie… Il y a en revanche un troisième aspect à prendre en compte dans cette réflexion, c’est celui que nous appellerons le business. Je le schématiserai autour de deux idées.
D’un côté, il y a les donneurs d’ordre, avec trois intervenants différents : celui qui connaît la sécurité, celui qui achète et celui qui paie. Ces trois acteurs ne sont pas toujours en phase sur la question classique de savoir s’il ne faudrait pas payer un peu plus d’entrée de jeu pour une meilleure sécurité afin de réduire le risque de catastrophe et de coûts énormes a posteriori. C’est le dilemme permanent de la maîtrise des coûts versus l’investissement. S’ils ont du mal à se mettre d’accord, c’est que la notion de coût du risque est rarement maîtrisée. Cela ne contribue pas à simplifier les choses et, dans des cas extrêmes, conduit à l’explosion de Lubrizol2, aux crashs des Boeing 737 Max 83 ou à l’incendie de Notre-Dame4.
De l’autre côté, il y a la spécificité du business model des entreprises de sécurité privée : leur capacité économique à investir. On sait qu’elle n’existe quasiment pas à cause des très faibles marges de ce métier ; cela ne contribue pas à développer les compétences et, par extension, à diminuer la complexité de leur situation sur le premier point que nous avons évoqué. Sans parler du fait que, sans investissement pas d’innovation, et sans innovation pas de proposition de création de valeur pour leurs clients.
SGP : Une solution de sécurité n’est donc jamais simple à mettre en œuvre : dans le meilleur des cas cela est compliqué et le plus souvent complexe.
Michel Mathieu : Comme dans tous les métiers, quand on entre dans une réelle compréhension des business models de chacun, quand on essaye de conceptualiser un minimum les fondamentaux et les chaînes de valeur, c’est toujours plus complexe que ce que l’on pouvait penser. C’est le phénomène de l’iceberg : sans plonger, sans travail sérieux, sans temps pour le faire, on ne voit que la petite partie visible, c’est la différence entre un touriste et un professionnel.
SGP : Comment va évoluer cette complexité dans les années à venir et, si je vous suis bien, que faudrait-il faire pour ne rester que dans le compliqué ?
Michel Mathieu : C’est enfoncer une porte ouverte que de dire que le monde est de plus en plus complexe. Certains individus semblent même très actifs actuellement pour nous créer le chaos, qui est la phase où la complexité devient hors contrôle. L’augmentation des risques, tant dans leur niveau que dans leur nombre est forcément un élément qui augmente la complexité. Mais souvenez-vous du premier point de notre entretien : on réduit la complexité par la compétence et, dans une moindre mesure, par l’expérience qui développe naturellement le savoir-faire. Une entreprise, ou un métier dans son ensemble, sera toujours meilleure si elle investit dans la compétence, donc dans la formation. Encore faut-il que l’on sache à quoi former et qu’il ne soit pas trop tard.
Dans le cas de Boeing, que j’ai beaucoup étudié, la recherche de profit jusqu’à un niveau indécent a provoqué quinze ans de coupes dans les compétences et l’expérience. Aujourd’hui, Boeing doit former 30 000 nouveaux salariés pour se sortir de la crise. Ils en ont pris conscience en 2024, mais est-il possible de former 30 000 personnes ? Et qui reste-t-il dans cette organisation qui ait encore l’expertise sur les fondamentaux et qui, en plus, aurait la compétence pour les transmettre de façon industrielle à 30 000 personnes ? C’est bien sûr un cas extrême, mais le problème de compétence est immense dans notre économie occidentale, c’est une épidémie touchant d’abord les grandes structures ; certaines grandes entreprises de la sécurité privée semblent être dans une trajectoire négative sur ce point.
SGP : Quels seraient les axes de travail à envisager pour qu’une solution de sécurité soit moins complexe à mettre en œuvre ?
Michel Mathieu : Qui sont les architectes de solutions ? Où sont-ils formés ? Qui apporte un travail de recherche et de conceptualisation sur ce sujet dans le monde de la sécurité privée ? Il faudrait s’inspirer de ce qui est fait ailleurs. Ce travail existe dans le monde militaire depuis le général Sun Tzu5, cinq siècles avant J. C., puis avec César6 ou plus récemment avec des stratèges comme Clausewitz7 ou Jomini8. Nul doute que cela existe en sécurité publique quand on voit les évolutions des doctrines de maintien de l’ordre par exemple. Donneur d’ordre, sécurité privée et autorités devraient s’associer pour développer et partager un pôle de compétence dans le domaine. À l’échelle des sociétés de sécurité privée, je reste convaincu que le meilleur investissement, avant toute autre ambition, reste la formation et la gestion des compétences.
- L’hypervision est un type de logiciel qui, depuis une plateforme unique appelée « hyperviseur », permet à une entreprise de contrôler et de gérer tous les systèmes de sécurité, de sûreté et de confort installés dans ses bâtiments. ↩︎
- L’incendie de l’usine Lubrizol et des entrepôts de Normandie Logistique, à Rouen, a eu lieu le
26 septembre 2019 dans une usine de produits chimiques de la société Lubrizol, classée Seveso seuil haut (« à haut risque »). ↩︎ - Ces deux accidents avaient coûté la vie à 346 personnes en 2018 et en 2019. ↩︎
- Cet incendie majeur, survenu à la cathédrale Notre-Dame de Paris les 15 et 16 avril 2019, dura pendant près de quinze heures. ↩︎
- Sun Tzu, général chinois du VIe siècle av. J.-C. (-544 -496)., surtout populaire comme auteur de l’ouvrage de
stratégie militaire le plus ancien, L’Art de la guerre. L’idée principale de son œuvre est que l’objectif de la guerre est de contraindre l’ennemi à abandonner la lutte, y compris sans combat, grâce à la ruse, l’espionnage, une grande mobilité et l’adaptation à la stratégie de l’adversaire. Tous ces moyens doivent être employés afin de s’assurer une victoire au moindre coût, humain et matériel. ↩︎ - Jules César (-100 -44), homme d’État, stratège et tacticien romain, auteur de Commentaires sur la guerre des Gaules et de Commentaires sur la guerre civile. ↩︎
- Carl von Clausewitz (1780-1831), officier général et théoricien militaire prussien, auteur en particulier d’un traité majeur de stratégie militaire intitulé De la guerre. ↩︎
- Antoine de Jomini (1779-1869), historien des guerres napoléoniennes et théoricien militaire suisse, dont le Précis de l’art de la guerre, un guide sur les mécanismes des opérations militaires, fut enseigné dans les écoles d’état-major de Russie, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, de Belgique et des États-Unis. ↩︎